Chroniques d’un éducateur devenu usager
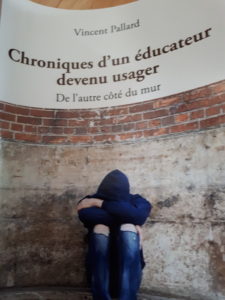 Je vais être assez critique à l’égard de cet ouvrage dont, malgré tout, une forme d’excellence tient dans la façon qu’il a de penser l’exercice du pouvoir ainsi que le rapport de la distinction et du même dans les métiers de la relation d’aide sociale, éducative et de soin. Critique car il me faut d’abord revenir sur le titre et préciser que l’éducateur en question, l’auteur donc, n’est pas « devenu usager »… il l’était avant même de devenir éducateur ! Cette part de lui-même était tenue refoulée jusqu’à ce que, et selon ses propres mots, la rencontre avec le public adolescent vienne réactiver une « enfance encore en indigestion » (p.64). C’est donc un être abîmé qui écrit et porte ses maux à bout de plume ; c’est un être qui, même au terme de son propos, se dit encore « individu hybride. Mi-éducateur, mi-usager » (p.206). C’est donc un livre à lire par tout étudiant en voie de professionnalisation car très éclairant sur cette part de travail sur soi à mener avant que de prétendre vouloir aider un autre que soi. Le livre est facile à lire ; il est construit à la manière d’un mille-feuille, avec ses couches de témoignage sur la vie en clinique psychiatrique entre lesquelles se glisse une crème de réflexion sur l’exercice des métiers de soignant ou d’accompagnant éducatif. Reste que, et pour contredire l’un des tout derniers mots de l’auteur, page 208, je ne crois pas qu’une posture professionnelle soit « à conquérir » ; elle est « à construire ». La différence dans la stratégie que cela implique est de taille. C’est pourquoi ce très bel ouvrage devrait être accompagné d’un appareil critique. Pour cela, et afin de n’être pas trop long, j’ai choisi de porter mon attention sur quatre notions, la réparation, l’équation, le temps et le pouvoir, que l’auteur par son témoignage et ses réflexions aide à hisser au rang de concepts praxéologiques.
Je vais être assez critique à l’égard de cet ouvrage dont, malgré tout, une forme d’excellence tient dans la façon qu’il a de penser l’exercice du pouvoir ainsi que le rapport de la distinction et du même dans les métiers de la relation d’aide sociale, éducative et de soin. Critique car il me faut d’abord revenir sur le titre et préciser que l’éducateur en question, l’auteur donc, n’est pas « devenu usager »… il l’était avant même de devenir éducateur ! Cette part de lui-même était tenue refoulée jusqu’à ce que, et selon ses propres mots, la rencontre avec le public adolescent vienne réactiver une « enfance encore en indigestion » (p.64). C’est donc un être abîmé qui écrit et porte ses maux à bout de plume ; c’est un être qui, même au terme de son propos, se dit encore « individu hybride. Mi-éducateur, mi-usager » (p.206). C’est donc un livre à lire par tout étudiant en voie de professionnalisation car très éclairant sur cette part de travail sur soi à mener avant que de prétendre vouloir aider un autre que soi. Le livre est facile à lire ; il est construit à la manière d’un mille-feuille, avec ses couches de témoignage sur la vie en clinique psychiatrique entre lesquelles se glisse une crème de réflexion sur l’exercice des métiers de soignant ou d’accompagnant éducatif. Reste que, et pour contredire l’un des tout derniers mots de l’auteur, page 208, je ne crois pas qu’une posture professionnelle soit « à conquérir » ; elle est « à construire ». La différence dans la stratégie que cela implique est de taille. C’est pourquoi ce très bel ouvrage devrait être accompagné d’un appareil critique. Pour cela, et afin de n’être pas trop long, j’ai choisi de porter mon attention sur quatre notions, la réparation, l’équation, le temps et le pouvoir, que l’auteur par son témoignage et ses réflexions aide à hisser au rang de concepts praxéologiques.
De la réparation
« Je reste également convaincu que le désir de réparation existe et fonctionne « naturellement » dans tout le fonctionnement humain. Jusque y compris dans les relations amicales, amoureuses, professionnelles » (pp. 64-65). Ainsi, l’auteur reprend à son compte une notion ayant eu son temps de gloire au moment où, la profession se laïcisant, l’engagement cessait d’être une vocation. De la compassion à la réparation, d’un regard focalisé sur l’autre à une attention portée à soi, se trouvait ainsi maintenue une passerelle entre Soi et l’Autre ; laquelle passerelle devait être forcément soumise à des torsions dès lors que la réparation tirait plus du côté de l’accompagnant que de l’accompagné, de l’éducateur plutôt que de l’éduqué. Et elle tire trop du côté de l’éducateur chaque fois que celui-ci est rattrapé par « ses démons » (p. 203). Ce que traduit aussitôt l’auteur en affirmant « qui de mieux placé pour parler l’angoisse qu’un angoissé ? Qui de mieux placé pour parler abandon qu’un enfant confié ? Qui de mieux placer pour parler violence qu’une femme battue ? » (p.66). Ce type d’arguments, dits de bon sens et fréquemment partagés par l’opinion publique, fiche en l’air les métiers de l’humain; il donne à croire qu’il suffit de faire l’expérience de la vulnérabilité pour prendre légitimement une place d’accompagnant auprès de personnes elles-mêmes vulnérables. Or une telle expérience ne fait sens que si elle est travaillée, transformée, sublimée… ce que tente d’ailleurs de faire l’auteur. Et je comprends fort bien qu’il puisse mobiliser les notions de transfert et de contre-transfert pour évoquer ce qui se trame dans la relation… Sauf que sur ce point aussi je demeure critique ! La relation éducative n’étant pas une relation thérapeutique, le lien nécessaire au déplacement de soi et de l’autre devrait trouver à s’exprimer par d’autres termes que ceux de la cure psychanalytique.
D’une équation
« On en extrait des recettes, des « tambouilles spécialisées ». On pourrait même s’imaginer l’espace d’une seconde que l’équation d’une relation soit composée du même type de variables qu’une équation mathématique. » (p.80) Il est curieux de constater comment ces arguments viennent à l’inverse de ce qu’ils sont supposés dénoncer. Car, en effet, l’art de la relation d’aide sociale, éducative et de soin relève autant de la recette que de l’équation; encore faut-il s’employer à retrouver le sens de chacun de ces mots. Ainsi, tout amateur de bonne cuisine sait combien une « recette » contient forcément une part d’inventivité et de créativité qui laisse au maître queue le soin d’apporter ce grain de sel qui fait toute la distinction entre deux plats en apparence identiques. La praxéologie, la science d’une pratique, est tout comme un livre de recettes ; c’est-à-dire un condensé d’instructions laissant une part de liberté à celui qui les applique, non pour faire ce qu’il veut mais pour maintenir le souci de l’autre. De même, et contrairement à l’auteur, je me plais à croire que la relation puisse être comparée à une équation à multiples variables. Parce que toutes les trajectoires de vie sont à la fois incroyablement similaires et incroyablement différentes. Et c’est bien cela une équation : un calcul dont les variables laissent ouverts les possibles d’une trajectoires. Il ne s’agit pas de s’octroyer une scientificité à moindre prix, mais bel et bien de chercher à fonder une science de l’éducation, que pour ma part je situe comme étant la science des limites de l’homme. De fait, j’ai du mal à lire l’auteur lorsque du fond de sa souffrance il dénonce « les balises de notre prétendu savoir » (pp.78-82). A quelle reconnaissance souhaitons-nous atteindre si nous sabordons nous-mêmes nos métiers ? Ne cherchons pas plus longtemps d’où vient le manque de considération à leur égard si nous en sommes les premiers naufrageurs ! Alors que, et à bien le lire entre les lignes, l’auteur perçoit parfaitement le point d’écueil lorsqu’il dénonce les méfaits d’un agir tout-puissant. Il ne s’agit donc pas de renoncer à une science de nos métiers mais d’apprendre à agir un savoir qui ne soit pas un instrument de pouvoir.
Du temps et du pouvoir
Et quel plus bel instrument de pouvoir que le temps dès lors que celui-ci cesse d’être celui des soignés pour devenir celui des soignants ! Sur ce point, l’auteur est sans retenu et nous sommes parfaitement en accord avec lui. Il raconte comment, dans la réalité quotidienne de la clinique psychiatrique, sont organisées de longues files d’attentes devant le bureau du psychiatre ou celui des soignants lors des « jours de la pesée et des prises de constantes » (p.69). Comment des activités dûment programmées sont impunément supprimées. L’analyse de l’auteur est extrêmement pertinente dès lors qu’il décode comment cette façon d’organiser le temps du point de vue du soignant assigne le soigné à n’être pas autre chose qu’un éternel soigné. Il est des pratiques qui en figeant le temps interdisent les déplacements attendus. De même qu’un morcellement soigneusement programmé du temps réduit l’être à une succession de paraître n’ayant d’autres liens entre eux que la volonté des soignants ; le fil conducteur de sa vie demeurant à jamais extérieur à la personne. Tout comme le fait que chaque nouveau soignant demande au soigné de répéter son histoire contraint celui-ci à renouveler sa « descente chronologique aux enfers ». Alors que si les informations étaient consignées dans le dossier de la personne et que si les professionnels faisaient acte de professionnalisme en consultant ce dossier avant de rencontrer la dite personne, d’inutiles souffrances seraient évitées et de possibles déplacements de trajectoire de vie rendus visibles. Mais revenons une dernière fois au titre, ou plutôt à son sous-titre « De l’autre côté du mur ». Une tendresse toute particulière pour Lewis Carrol et les analyses de Michel Foucault dans Herculine B, dite Alexina B. m’aurait fait préférer « De l’autre côté du miroir ». Car nul ne passe impunément de l’autre côté ! Cette transgression inopportune forge chez l’auteur un regard dur et sans appel (il s’en excuse à la fin de l’ouvrage) à l’égard des éducateurs et des soignants accusés d’occuper trop fréquemment la place de « grand sachant » afin de mieux reléguer l’accompagné à celle d’un « rien sachant ». Un tel regard fait mal à l’ensemble des professions, quand bien même il contiendrait une part de vérité. Et puisque l’auteur se dit lui-même un temps séduit par la psychiatrie institutionnelle, il doit savoir, grâce aux leçons de Jean Oury, de Lucien Bonnafé, de Stanislas Tomkiewicz et tant d’autres, qu’il est possible de faire du savoir non pas une ligne de démarcation mais un trait d’union entre l’accompagnant et l’accompagné.
Quoi qu’il en soit, et au terme d’une lecture plaisante bien que critique, il me reste à l’esprit une tendresse particulière pour cet ouvrage ; car, à sa manière, il contribue au combat engagé en faveur de la survie des métiers de l’humain.